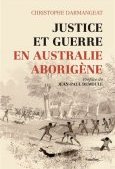La biologie permet-elle d’expliquer le social ?
Publié en ligne le 8 mai 2021 - Évolution et faits sociaux -
La biologie permettrait-elle de rendre compte du fonctionnement de notre vie sociale de manière plus convaincante et rigoureuse que ne le fait la sociologie ? C’est ce que soutiennent les tenants d’approches scientifiques telles que la sociobiologie ou la psychologie évolutionnaire, dont l’objectif est d’expliquer les phénomènes sociaux en s’appuyant sur la biologie de l’évolution contemporaine. Ces approches dites « naturalistes » – car elles font usage de théories et de connaissances issues des sciences de la nature – sont généralement décriées par les chercheurs en sciences de la société et de la culture, qui les accusent d’être illégitimes, erronées, voire dangereuses (voir par exemple [1, 2]).

F. G.Weitsch (1758-1828)
La sombre histoire du naturalisme
Si les approches naturalistes du social et de la culture reviennent actuellement sur le devant de la scène et font polémique, elles ne constituent en rien une nouveauté historique. En effet, les premières d’entre elles ont été développées au XIXe siècle déjà. Comme l’a proposé le sociologue Dominique Guillo, spécialiste de la question, les approches naturalistes d’alors et d’aujourd’hui peuvent globalement être classées en deux grandes catégories, selon le rôle qu’y joue la biologie [3].
Premièrement, dans le cadre des approches naturalistes dites « analogiques », il s’agit d’expliquer le social ou la culture à la manière dont la biologie rend compte du vivant. Un tel recours analogique à la biologie était courant dans les théories sociologiques et anthropologiques de la seconde moitié du XIXe siècle. À cette époque, le transformisme l’emporte progressivement en biologie sur le fixisme : le fait que les espèces animales ne sont pas fixées une fois pour toutes, mais se transforment au fil du temps, était de plus en plus largement accepté. Si la nature des mécanismes régissant ces transformations faisait encore débat, le processus d’évolution des espèces était souvent vu (plus ou moins explicitement) comme un processus d’amélioration, de progrès du vivant. L’idée était que les espèces se développaient par complexification de leur organisation anatomique en direction de formes toujours plus abouties et subtiles – autrement dit, « supérieures ». Dès lors, le degré de sophistication anatomique des différentes espèces animales constituait le critère qui permettait de les classer en une série zoologique allant des moins au plus « évoluées » – notre espèce occupant, bien entendu, l’ultime échelon de cette échelle hiérarchique des êtres.
De nombreux philosophes, sociologues et anthropologues du XIXe siècle appliquèrent par analogie aux sociétés humaines cette conception transformiste, progressiste et finaliste de l’histoire naturelle. Les sociétés, à l’image des êtres vivants, étaient ainsi vues comme des entités susceptibles d’être classées en une « série sociologique » selon la complexité de leur mode d’organisation interne – une idée que l’on retrouve, par exemple, chez le sociologue Émile Durkheim (1858-1917) [3]. De même, au cours du temps et à des rythmes variables, l’organisation de chaque société était censée se complexifier sous l’effet de mécanismes analogues à ceux supposés régir l’évolution des espèces (« lutte pour la survie », « adaptation », etc.).
Selon certains chercheurs de l’époque, les formes culturelles étaient, elles aussi, soumises aux lois universelles du progrès. Ainsi, l’anthropologue Lewis Henry Morgan (1818-1881) pensait-il que l’évolution culturelle devait tôt ou tard conduire les diverses sociétés humaines à transiter d’un « état de sauvagerie » initial à l’« état de civilisation », en passant par un « état de barbarie » intermédiaire [4]. Dans cette optique, les sociétés « exotiques » étudiées par les anthropologues constituaient des sociétés « primitives » n’ayant pas encore franchi telle ou telle étape du « progrès culturel » (voir encadré ci-dessous).

Anonyme (Schaffer Library, Union College
En étant le premier à entreprendre l’étude scientifique des systèmes de parenté, en se livrant notamment à l’étude directe des peuples amérindiens, l’Américain Lewis Morgan a posé les fondements de l’anthropologie sociale. Il a aussi, dans La Société archaïque (1877), présenté une théorie générale de l’histoire des sociétés basée sur l’idée d’une séquence évolutive commune, pour l’essentiel, à l’ensemble des sociétés. Dans cet ouvrage, comme le note l’historienne Michèle Duchet, « l’affirmation fondamentale de Morgan est celle qui fait de la connaissance de toutes les ethnies la condition même de l’étude de l’histoire humaine. Toutes les tribus, les peuples, les nations représentent un état particulier dans un devenir de l’espèce commun à tous les groupes humains » [1]. Ainsi, « ce que l’on doit d’abord à Morgan – et il faut le rappeler, tant la chose aujourd’hui paraît aller de soi –, c’est la claire idée que toute société est dans l’histoire et qu’elle se transforme ». Ce sont par conséquent les mêmes méthodes qui doivent présider à l’étude de toutes les sociétés : « Des sociétés les plus archaïques aux sociétés les plus civilisées, le principe de l’analyse ne change pas. »
Selon le trajet évolutif tracé par Morgan, « toutes les sociétés humaines passent par des phases d’évolution identiques, et à chaque stade d’évolution correspond un type d’organisation économique, politique, familial, technique spécifique. De la sorte, en connaissant l’état technique d’une société par exemple, on peut en déduire les autres formes sociales (religion, économie, forme familiale) et son degré d’avancement dans l’échelle de l’évolution » [2].
Il y a ainsi trois grands stades d’évolution : la « sauvagerie » (notre état originel de chasseurs-cueilleurs), la « barbarie » (commençant grosso modo au Néolithique, le saut déterminant étant l’invention de la poterie – non de l’agriculture) et la « civilisation » consacrée par l’adoption de l’écriture. Chaque stade est lui-même divisé en trois subdivisions plus fines délimitées par d’autres avancées et mutations.
Morgan a compensé la faiblesse des données disponibles à son époque grâce au canevas rigide ainsi déployé, mais aussi en puisant dans les idées de son milieu. Morgan était selon les critères de son temps un républicain progressiste, favorable aux droits des Indiens et à l’émancipation des femmes ; La Société archaïque « est une histoire des institutions des sociétés anciennes, antiques ou archaïques, mais c’est aussi un projet pour l’avenir, lequel est pensé sous la forme d’une grande synthèse des modes démocratiques déjà expérimentés » [3].
In fine, bien des idées de Morgan sur l’évolution des sociétés n’ont pas résisté à l’accumulation des connaissances historiques et ethnologiques. Cependant, son travail est fondateur, et Maurice Godelier pouvait ainsi affirmer que « Morgan domine, de nos jours encore, l’histoire de l’anthropologie de toute la richesse et de l’ambiguïté de son œuvre » [4].
Antoine Pitrou
Références
1 | Duchet M, « La société archaïque de Lewis Morgan », Le Partage des savoirs. Discours historique, discours ethnologique, La Découverte, 1984, chapitre 6, 133-70.
2 | Dortier JF, « Lewis Henry Morgan. Rencontre avec les Iroquois », in Dortier JF, Une histoire des sciences humaines, Éditions Sciences Humaines, 2012, 74-81.
3 | Raulin A, « Sur la vie et le temps de Lewis Henry Morgan », L’Homme, 2010, 195-196 :225-46.
4 | Godelier M, « Morgan Lewis Henry (1818-1881) », Encyclopædia Universalis. Note initialement publiée en 1971, contenu validé de nouveau par l’auteur (correspondance privée).
À côté de ce naturalisme analogique, on trouve un second type d’approches naturalistes, qualifié de « direct ». Il s’agit cette fois de recourir à la biologie non plus par analogie, mais directement pour expliquer un phénomène social ou culturel donné. C’est le cas, par exemple, des théories du XIXe siècle qui expliquaient les comportements « déviants » – criminalité, prostitution, etc. – comme résultant causalement de la possession de caractéristiques biologiques particulières. L’on se mit alors à rechercher chez les individus concernés des traits anatomiques susceptibles de signaler la possession de telles caractéristiques.
Ainsi, Cesare Lombroso (1835-1909) prétendit-il dans L’homme criminel (1876) avoir identifié des traits anatomiques – forme du crâne, de la dentition, longueur des bras, etc. – associés à différents types de délinquants. Selon lui, cela prouvait, premièrement, que les comportements criminels sont bien causés par des caractéristiques biologiques se manifestant par ailleurs dans l’anatomie des individus et, deuxièmement, que la criminalité est au moins en partie innée et héréditaire. Pour Lombroso, les caractéristiques biologiques responsables des comportements criminels résultaient elles-mêmes d’un processus de « régression évolutive », qui rapprochait les personnes concernées de nos ancêtres simiesques (d’où le fait, par exemple, que ces personnes étaient censées avoir des bras spécialement longs, plus proches de ceux des singes que des humains « pleinement évolués »).
Au vu de ces exemples historiques, on comprend mieux pourquoi le naturalisme, qu’il soit analogique ou direct, rencontre aujourd’hui l’hostilité de bien des chercheurs en sciences de la société et de la culture. Dominique Guillo rappelle pourtant que si, en raison de la compréhension du vivant qui prévalait alors, « le naturalisme du dix-neuvième était condamné, par essence, à déployer une conception historiciste, hiérarchique et discriminatoire de l’homme, le naturalisme d’aujourd’hui peut y échapper, même si ce n’est pas toujours le cas » [3].
Les naturalismes contemporains
La mémétique

Abraham Teniers (1629-1670)
Le naturalisme analogique le plus connu de nos jours est la « mémétique », une approche proposée au milieu des années 1970 par le biologiste Richard Dawkins [5]. L’ambition de la mémétique est, là encore, d’expliquer l’évolution culturelle d’une manière analogue à celle utilisée pour rendre compte de l’évolution du vivant. La biologie contemporaine le fait en analysant les processus sélectifs qui opèrent au niveau d’un « pool génétique » donné, à savoir, au niveau de l’ensemble des gènes présents au sein d’une population d’organismes interféconds.
L’idée de Dawkins est que ce modèle sélectif pourrait être appliqué par analogie à de petites unités culturelles comparables aux gènes : les « mèmes ».
Un mème peut être une croyance, une idée, une histoire, une façon de manger, de se comporter, etc. Le point central est que, comme les gènes, les mèmes seraient des réplicateurs : des entités capables de produire des copies d’elles-mêmes. Si les gènes se répliquent et se diffusent par la reproduction des organismes qui les portent, les mèmes le font par imitation – « en sautant de cerveau en cerveau », nous dit Dawkins [5]. Or certains mèmes sont davantage imités que d’autres, ce qui fait qu’on en retrouve au fil du temps une copie dans un nombre croissant de cerveaux. Autrement dit, tout comme certains gènes sont sélectionnés et d’autres non au sein d’une population, les mèmes ne connaissent pas tous un succès identique : certains disparaissent rapidement, tandis que d’autres se répliqueront et habiteront les esprits des individus sur plusieurs générations – c’est le cas, par exemple, des mèmes « dieu chrétien » ou « histoire du petit chaperon rouge ». Dans ce contexte, expliquer l’évolution culturelle reviendrait à analyser les processus sélectifs qui opèrent au niveau d’un « pool mémétique », c’est-à-dire, d’une culture.
Il faut souligner que si, selon les méméticiens, l’évolution culturelle se fait de manière analogue à l’évolution biologique, la première demeure largement indépendante de la seconde. En effet, un mème n’a pas besoin de conférer un quelconque avantage sur le plan biologique pour se diffuser. Pour y parvenir, il lui suffit d’être attractif. Ainsi, un mème peut tout à fait connaître une importante diffusion tout en ayant pour conséquence de diminuer le potentiel reproductif des individus qui l’ont en tête. Pour illustrer ce point, Dawkins donne l’exemple du célibat des prêtres. Il s’agit là d’un mème « contre-adaptatif » d’un point de vue biologique pour les prêtres, dans la mesure où il leur interdit d’avoir des descendants. Cependant, rien ne l’empêche d’essaimer dans l’esprit de nombreux individus, puisque sa diffusion ne passe pas par la reproduction, mais par l’imitation.
Si la mémétique a pu susciter un certain enthousiasme, il paraît aujourd’hui évident qu’elle est vouée à l’échec. En effet, l’analogie sur laquelle repose cette approche ne résiste pas à l’analyse [6]. Les copies d’un gène qui circulent au sein d’une population en sont réellement des copies : elles ont exactement la même structure chimique que le gène original. Il n’est dès lors pas abusif d’affirmer qu’un gène identique est porté par plusieurs individus de la population. La situation est bien différente en ce qui concerne les mèmes : il n’existe pas deux personnes qui partagent exactement la même conception du dieu chrétien, par exemple. Cela découle du fait que les mèmes se transmettent par imitation, et non par reproduction. Or, imiter le comportement ou les idées des autres revient à s’en former une représentation à partir de leur expression publique. Autrement dit, à la différence des gènes, les mèmes ne se répliquent pas, mais ils sont plus ou moins fidèlement interprétés et reconstruits par les imitateurs.
En raison de cette différence fondamentale, il est peu probable que les éventuels mécanismes qui président à la sélection des mèmes au sein d’un pool mémétique soient similaires à ceux qui s’appliquent à la sélection des gènes au sein d’un pool génétique. La théorie de l’évolution naturelle ne peut donc pas être utilisée par analogie pour rendre compte de la diffusion de pratiques ou de représentations socioculturelles. Mais peut-elle l’être directement ?
La sociobiologie
C’est ce que pensent les tenants de la sociobiologie et de la psychologie évolutionnaire. Les sociobiologistes rappellent que la théorie de l’évolution ne s’applique pas uniquement aux propriétés physiques des animaux, mais également à certaines de leurs propriétés comportementales – celles dont l’expression est plus ou moins directement commandée par les gènes des individus. En effet, la sélection naturelle opère sur n’importe quel trait hérité ou apparu par mutation lors du processus reproductif qui influence la capacité des organismes à transmettre leur patrimoine génétique : si ce trait diminue leur capacité à le faire, il disparaîtra à terme de la population à laquelle ils appartiennent ; s’il l’augmente au contraire, les gènes qui codent pour ce trait seront portés par un nombre croissant d’individus de cette population au fil des générations. Tout comme nos propriétés anatomiques, certains de nos comportements héréditaires, y compris sociaux, ont été sélectionnés de la sorte au cours de la phylogenèse (l’histoire évolutive) de notre espèce.
Selon les sociobiologistes, cela permettrait d’expliquer quantité de phénomènes socioculturels [7]. Par exemple, ceux de nos lointains ancêtres qui étaient génétiquement prédisposés à éviter d’entretenir des relations sexuelles incestueuses possédaient un avantage évolutif sur leurs congénères qui ne l’étaient pas. En effet, cela diminuait le risque de voir naître au sein de leur famille des enfants atteints de maladies ou de tares génétiques pouvant compromettre l’avenir de leur lignée, autrement dit, de leur patrimoine génétique. Le comportement d’évitement de l’inceste aurait ainsi été sélectionné au cours de la phylogenèse de notre espèce, sans que, bien entendu, les individus en comprennent les raisons évolutives. Sur cette base, la plupart des cultures humaines auraient alors institué des tabous, des normes ou des lois prohibant formellement les relations incestueuses et leur auraient trouvé diverses justifications symboliques, religieuses ou morales. De tels interdits socioculturels viendraient en quelque sorte redoubler notre tendance spontanée à éviter d’entretenir des relations sexuelles avec de proches parents. Mais l’existence même de ces interdits socioculturels s’expliquerait bel et bien directement par notre inclination naturelle, sélectionnée, à éviter l’inceste.
Au moment où la sociobiologie a commencé à se développer, les sciences cognitives étaient encore embryonnaires. Les mécanismes cognitifs (les mécanismes de traitement de l’information) qui régulent les comportements humains demeuraient donc largement mystérieux. Or, ces mécanismes ont eux aussi été sélectionnés au cours de la phylogenèse de notre espèce. Ils devraient dès lors nous permettre d’expliquer plus précisément certains phénomènes socioculturels. Grâce au développement des sciences cognitives, on en connaît désormais davantage sur la manière dont notre esprit organise et traite les informations en provenance de notre environnement. Forte de ces connaissances nouvelles, la sociobiologie s’est progressivement muée en une psychologie évolutionnaire [8]. L’ambition de cette dernière demeure la même : expliquer les phénomènes socioculturels en montrant de quelle manière ils résultent de propriétés sélectionnées au cours de notre histoire évolutive, mais en mettant davantage l’accent sur les propriétés naturelles de notre système cognitif.
La psychologie évolutionnaire
Selon les psychologues évolutionnaires, l’évolution a structuré l’esprit humain en un ensemble de modules cognitifs. Chacun de ces modules est spécialisé dans la détection et le traitement d’un type particulier d’informations. Il existe, par exemple, un module cognitif dédié à la détection des visages humains présents dans notre environnement visuel [9], et un autre spécialisé dans la détection des araignées et des serpents qui s’y trouvent [10]. Les entités ayant donné lieu à la sélection de tels modules cognitifs sont celles dont la prise en compte pouvait impacter le potentiel de survie et de reproduction de nos ancêtres évolutifs. Lorsqu’une entité de ce type est détectée par le module cognitif qui lui est dédié, ce dernier déclenche des réponses cognitives et comportementales en fonction des informations collectées – par exemple, la vue d’un serpent à proximité de soi déclenche un sentiment de peur et la volonté de s’en éloigner.
Les partisans de la psychologie évolutionnaire et des approches qui y recourent, comme l’anthropologie cognitive (voir par exemple [11, 12]), soutiennent qu’il est nécessaire de tenir compte de cette architecture naturelle de notre esprit pour pouvoir expliquer de nombreux phénomènes socioculturels. Par exemple, le maquillage du visage est une pratique que l’on retrouve dans quantité de groupes humains. Si cette pratique connaît une telle diffusion, ce serait parce qu’elle exploite notre module cognitif de détection des visages [13]. En effet, le maquillage consiste souvent à souligner les traits saillants du visage. Les visages maquillés captent donc encore davantage notre attention que ceux qui ne le sont pas : ils constituent des « superstimuli » pour le module dédié à leur détection. Le maquillage du visage étant ainsi une pratique naturellement marquante pour tous les membres de notre espèce, on comprend qu’elle soit apparue et ait perduré dans de très nombreuses sociétés humaines. Le module de détection des visages dont est équipé notre système cognitif expliquerait donc directement l’origine et le succès transculturel rencontré par cette pratique somme toute assez singulière.
La psychologie évolutionnaire prétend pouvoir expliquer de la sorte une grande variété de phénomènes sociaux et culturels – du fonctionnement des comportements altruistes au favoritisme à l’égard des membres de son groupe d’appartenance, en passant par l’existence de certaines inégalités sociales, par exemple.
Pour un naturalisme intégratif

Joseph Kutter (1894-1941)
De nombreuses critiques sont adressées à la psychologie évolutionnaire. Certaines d’entre elles proviennent de chercheurs en sciences cognitives et portent notamment sur la conception excessivement « modulariste » de l’esprit qui y prévaut (voir par exemple [14]). Du côté des chercheurs en sciences sociales, deux critiques reviennent en particulier.
Premièrement, la psychologie évolutionnaire est une approche réductionniste : elle prétend expliquer quantité de phénomènes sociaux complexes en les réduisant à la manifestation d’un petit nombre de mécanismes biologicocognitifs. Or des aspects importants des phénomènes étudiés passent bien souvent à la trappe de ce réductionnisme. Par exemple, lorsqu’on explique le succès de la pratique du maquillage par l’existence d’un module cognitif dédié à la reconnaissance des visages, on ne rend nullement compte de la multitude de sens différents que peut revêtir cette pratique selon les époques ou les sociétés. Il s’agit pourtant là d’un aspect du phénomène au moins aussi intéressant que celui de son origine ou de son succès, et sur lequel il n’est pas sûr que la psychologie évolutionnaire ait grand-chose à dire.
Deuxièmement, elle est parfois accusée de naturaliser certaines inégalités sociales – les inégalités de genre, notamment (voir par exemple [1]). En effet, si l’on explique de telles inégalités à partir du fonctionnement naturel de notre cognition, il n’y a qu’un pas à franchir pour affirmer que ces inégalités sont elles-mêmes naturelles et qu’il est donc vain de chercher à les corriger, voire qu’il serait souhaitable de les perpétuer. Ce glissement fautif ne constitue cependant pas une fatalité : il relève de l’instrumentalisation idéologique d’une approche scientifique [3]. Instrumentalisation que les chercheurs du domaine devraient avoir à cœur de dénoncer chaque fois qu’ils en sont témoins.
Au final, s’il revient à la psychologie évolutionnaire de faire la preuve de la pertinence de son approche des phénomènes sociaux, il serait faux d’imaginer que cette discipline, ou tout autre naturalisme réductionniste, pourrait se substituer à la sociologie. Les « sciences de la nature humaine » – biologie de l’évolution, sciences cognitives, neurosciences, psychologie du développement – peuvent assurément nous aider à mieux comprendre certains aspects importants de notre vie sociale. Mais on ne peut faire l’économie de la conceptualisation et des descriptions riches du social que seules les sciences humaines et sociales sont à même d’apporter.
Il s’agit dès lors d’explorer une troisième forme de naturalisme : un naturalisme intégratif, au sein duquel des méthodes et des connaissances des sciences de la nature humaine seraient intégrées aux paradigmes sociologiques classiques [15]. Il est en effet temps de chercher à articuler ces disciplines pour parvenir à une compréhension scientifique du social aussi large et rigoureuse que possible.
1 | Jonas I, « Psychologie évolutionniste, mixité et sexisme bienveillant », Travail, genre et sociétés, 2010, 23 :205-11.
2 | McKinnon S, Neo-liberal Genetics : The Myths and Moral Tales of Evolutionary Psychology, Prickly Paradigm Press, 2005.
3 | Guillo D, « Les usages de la biologie en sciences sociales. Comparaison entre le naturalisme socio-anthropologique du dix-neuvième siècle et celui d’aujourd’hui », European Journal of Social Sciences, 2012.
4 | Morgan LH, Ancient Society, or Researches in the Line of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization, Macmillan and Co., 1877.
5 | Dawkins R, Le gène égoïste, Armand Colin, 1990 (1976).
6 | Guillo D, La Culture, le Gène et le Virus. La mémétique en question, Hermann, 2009.
7 | Wilson EO, Sociobiology. The New Synthesis, Harvard University Press, 1975.
8 | Tooby J, Cosmides L, « Conceptual foundations of evolutionary psychology », in Buss DM, The handbook of evolutionary psychology, John Wiley & Sons, 2005.
9 | Kanwisher N, Moscovitch M, « The cognitive neuroscience of face processing : An introduction », Cognitive Neuropsychology, 2000.
10 | Öhman A, Mineka S, « The malicious serpent snakes as a prototypical stimulus for an evolved module of fear », Current Directions in Psychological Science, 2003.
11 | Bloch M, L’anthropologie et le défi cognitif, Odile Jacob, 2013.
12 | Sperber D, « The modularity of thought and the epidemiology of representations », in Hirschfeld LA, Gelman SA, Mapping the Mind : Domain Specificity in Cognition and Culture, Cambridge University Press, 1994, 39-67.
13 | Sperber D, Hirschfeld LA, « The cognitive foundations of cultural stability and diversity », Trends in Cognitive Sciences, 2004.
14 | Bolhuis JJ et al., « Darwin in mind : New opportunities for evolutionary psychology », PLOS Biology, 2011.
15 | Cordonier L, La nature du social. L’apport ignoré des sciences cognitives, Presses universitaires de France, 2018.
Publié dans le n° 335 de la revue
Partager cet article
L'auteur
Laurent Cordonier

Docteur en sciences sociales et chercheur associé à l’université de Paris.
Plus d'informationsÉvolution et faits sociaux

L’évolution explique-t-elle les faits sociaux ?
Le 10 février 2021![[Lyon - Vendredi 07 novembre à 19h30] Sensibilité et conscience animale](local/cache-gd2/44/21874b572be71823fb33a09f47fb25.png?1762031823)
[Lyon - Vendredi 07 novembre à 19h30] Sensibilité et conscience animale
Le 7 novembre 2025
De l’humour dans la recherche scientifique
Le 19 juillet 2022
Risque de morsure de chien, ou le retour de la science
Le 31 mai 2022
La Science face à la conscience… animale
Le 18 septembre 2021