Malscience
Publié en ligne le 2 avril 2017De la fraude dans les labos
Nicolas Chevassus-au-Louis
Seuil, Coll. Science ouverte, 2016, 208 pages, 18 €
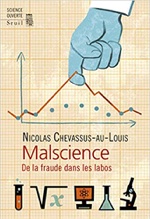
La « mauvaise science », la « malscience » dénoncée par Nicolas Chevassus-au-Louis, représente une véritable plaie dans le processus de production scientifique. De façon très complète, l’auteur entreprend une classification des différentes formes de fraude qui gangrènent la recherche scientifique. Cela va de la falsification ouverte et flagrante et de la manipulation délibérée de l’information scientifique jusqu’aux plagiats et divers « embellissements » pour mieux faire coller un résultat avec une hypothèse, en passant par les petits arrangements avec la vérité, jamais anodins. Aucun acteur n’est épargné, qu’il s’agisse des chercheurs eux-mêmes, des institutions scientifiques, de l’édition scientifique, de l’industrie, mais aussi de certaines ONG. Les descriptions sont détaillées et s’appuient sur de nombreux exemples. Si certaines affaires ont défrayé la chronique, comme celle du biologiste coréen Woo-suk Hwang affirmant avoir cloné un embryon humain pour en obtenir des cellules souches indispensables à la médecine régénérative, l’auteur montre qu’il ne s’agit là que de la très petite partie émergée d’un gigantesque iceberg. Les rétractations d’articles sont fréquentes, les revues prestigieuses ne sont pas les moins concernées. Il est facile, en payant, de publier à peu près n’importe quoi dans ce qu’on appelle des « revues prédatrices » et il est aussi possible, toujours en payant, d’accoler son nom à des articles sérieux dans des revues prestigieuses. Une importante proportion de figures ou de photos sont arrangées, des données sont trafiquées, d’autres sont mises à l’écart pour permettre de passer le « seuil » de résultats « significatifs »… Environ 2 % serait la proportion des « scientifiques [qui] admettent avoir une fois dans leur carrière fabriqué ou falsifié des résultats » (p. 38) alors que le taux global de rétractation est estimé à 0,02 % : seulement une étude frauduleuse sur cent est rétractée. L’auteur expose en outre quelques bonnes raisons de penser que le chiffre de 2 % est lui-même sous-évalué.
Pour Nicolas Chevassus-au-Louis, le mal est profond depuis l’explosion de la fraude constatée dans les années 1970. Et la communauté scientifique est largement dans le déni. Si certaines disciplines sont relativement épargnées, comme les mathématiques (essentiellement victimes de plagiats) ou la physique (où l’ampleur des dispositifs mis en œuvre et le nombre impressionnant de signataires d’un article permettent une certaine autorégulation par les collègues), d’autres, comme la chimie, la biologie ou les sciences humaines et sociales sont largement atteintes. Particulièrement inquiétant par ses conséquences, le domaine médical est proportionnellement le plus touché. Selon une étude citée dans le livre, « entre 2000 et 2010, 6573 patients ont reçu aux États-Unis des traitements expérimentaux dans des essais cliniques rétractés pour fraude » (p. 125).
Les conséquences de cette « déstabilisation de l’ensemble du système scientifique qu’entraîne la fraude » sont nombreuses : coût financier, ralentissement de l’avancée des découvertes et des applications. Ainsi, l’impossibilité de reproduire de nombreux résultats allégués dans la littérature biomédicale pourrait expliquer la chute constatée des taux de réussite des essais cliniques en phase II (où l’on teste l’efficacité des nouvelles molécules). Nicolas Chevassus-au-Louis, à ce propos, note qu’il est « piquant d’entendre les industriels, si souvent accusés de coupables dissimulations, donner des leçons de rigueur et d’intégrité aux chercheurs académiques » (p. 68). Pour eux, ce qui compte avant d’engager le milliard de dollars que coûte le développement d’un nouveau médicament, c’est que les résultats « soient robustes, fiables, parfaitement reproductibles » (p. 69).
Un chapitre s’attache à la manipulation scientifique au service d’enjeux économiques ou politiques. L’« effet financement » fait que, consciemment ou non, il arrive aux chercheurs d’« adapter leurs résultats, ou tout au moins leurs démarches de recherche, aux intérêts de ceux qui financent leurs travaux » (p. 100) et « le financement d’une recherche influe inéluctablement sur ses conclusions » (p. 102). L’exemple maintenant bien établi et documenté de l’industrie du tabac est rappelé. Mais Nicolas Chevassus-au-Louis décrit la « grande nouveauté de la dernière décennie » où « des groupes associatifs ont repris ces méthodes peu estimables de l’industrie ». Ainsi, explique-t-il, « un CRIIGEN 1 […] nous semble mener en matière de recherche sur les OGM le même rôle que le défunt Council for Tobacco Research financé par les cigarettiers américains : celui de procureur instruisant à charge une question scientifique sans le moindre souci d’impartialité. S’il est une conclusion à tirer de l’affaire Séralini, c’est assurément que, pour la première fois, un groupe associatif a recouru aux méthodes de l’industrie, convaincue depuis des décennies que rien ne vaut une publication scientifique pour défendre sa cause, et que peu importe la qualité du travail de recherche mené » (p. 108).
Au-delà d’un constat inquiétant, l’ouvrage propose une analyse des raisons de cette situation. Le “publish or perish” souvent invoqué, bien que réel, n’explique pas tout et l’auteur met également en cause « la réorganisation mondiale des laboratoires […] injectant la compétition à outrance, l’individualisme exacerbé et la prime au court terme, autrement dit, ce que le monde de l’entreprise a souvent de pire » (p. 10).
Mais finalement, « est-ce bien grave, […] tant que la science progresse ? ». La réponse de l’auteur, jugeant que « c’est la fiabilité même de l’édifice qui est aujourd’hui menacée » (p. 115),peut être considérée trop pessimiste, mais sa démonstration est étayée.
Le dernier chapitre est plus positif. Il s’attache à indiquer des solutions possibles dont certaines commencent à voir le jour, comme la constitution de comités d’éthique dans les principales institutions, le partage des données qui se met en place dans certaines disciplines. Face à cette « mal-science », Nicolas Chevassus-au-Louis plaide pour une « slow science », une science à gestation lente qui récuserait les « facteurs d’impact » des revues scientifiques, ne jugerait plus les chercheurs sur le nombre de publications et déciderait des allocations de ressources sur d’autres bases que les mesures bibliométriques. Un livre indispensable et qui prolonge utilement le dossier que Science et pseudo-sciences a publié dans son numéro 318 2.
1 CRIIGEN : Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique. ONG militant contre les OGM.
2 « Comment s’établit la vérité scientifique : le difficile chemin vers la connaissance », SPS n°318, octobre 2016.
Mots clé associés à cet article
Cet article appartient au sujet : Intégrité scientifique
Autres mots clés associés : Science















![[Paris - jeudi 29 janvier 2026 à 19h00] Sommes-nous en train de perdre le réel ?](local/cache-gd2/d4/e7f89971b20746e4ef5a5bdc24b558.png?1766062942)
















